Wikipédia
Julien Hébrard ∙05 Mai 2025∙ 2 min
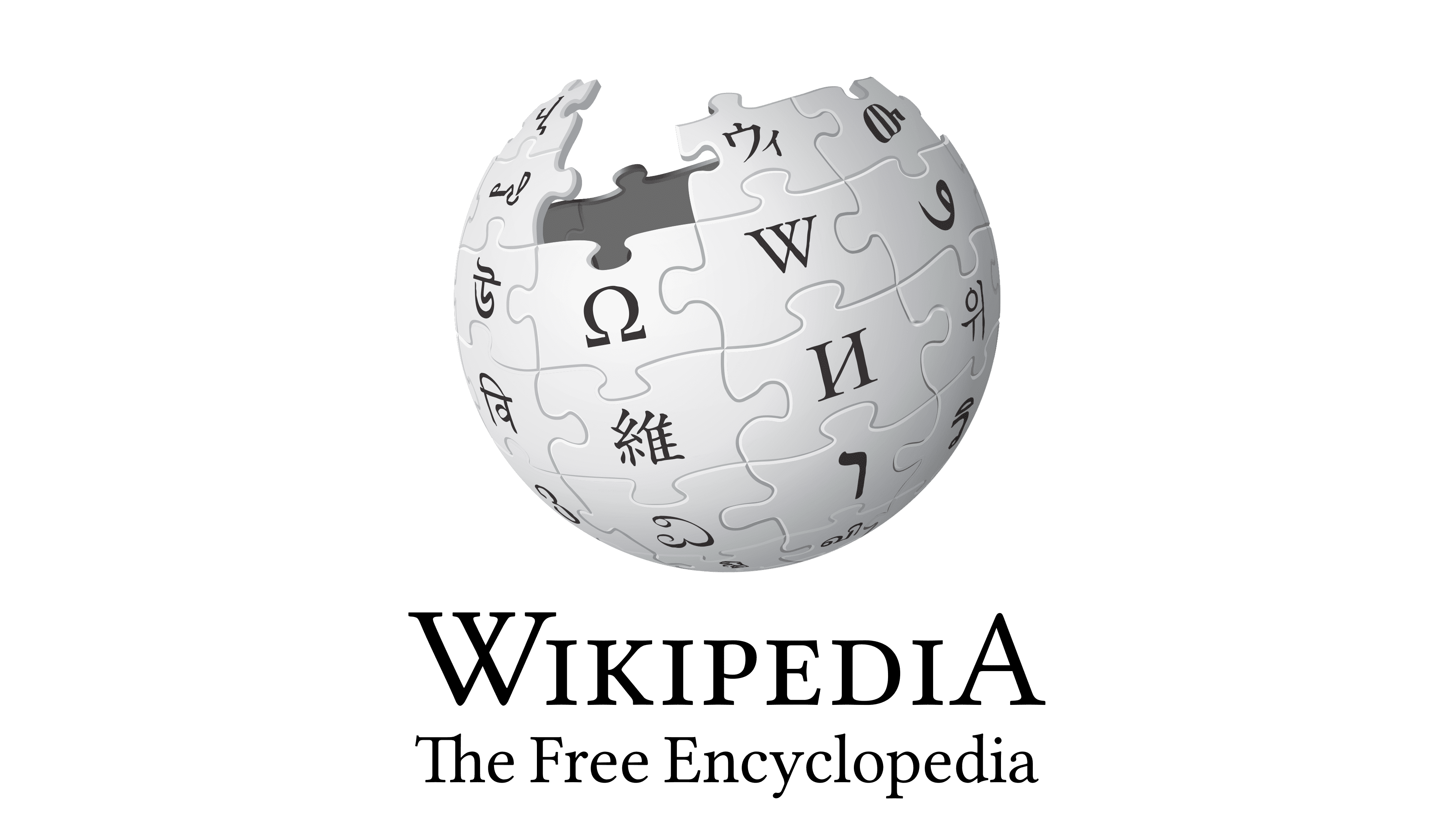
Wikipédia est, à de nombreux niveaux, le stade absolu de la démocratie. Tout y est décidé par la communauté : nomination (ou déchéance) des administrateurs, suppression de pages, sélection des articles primés… ou instauration de nouvelles règles. La démocratie c’est bien, mais la démocratie encadrée c’est mieux, sinon on tombe vite dans l’anarchie. Qui dit règles dit donc professionnalisation. Wikipédia est toujours ouverte à la contribution d’anonymes, ce qui est son principe fondateur. Néanmoins l’empilement des règles fait qu’aujourd’hui, savoir contribuer sur l’encyclopédie implique de plus en plus d’en connaître les arcanes.
Je fais partie de ceux qui contribuent depuis 2006. Les arcanes, j’ai donc eu le temps de les apprendre. C’est ce qui fait mon avantage comparatif. C’est aussi ce qui fait que même avec toute la bonne volonté du monde, une agence (SEO, relations presse, affaires publiques…) qui se lance sur ce créneau aura beaucoup de difficultés à réaliser une prestation aussi solide que la mienne. Pas parce que je suis plus productif, parce que j’écris mieux ou parce que je connais mieux le langage wiki. Mais parce que je connais la communauté, ses règles et ses subtilités.
Quand j’accepte une mission, il y a donc de très fortes chances que le projet aboutisse. En revanche, j’accepte rarement. Pas par manque de temps ou par méchanceté, mais parce que je sais que le sujet n’est pas admissible. Tout le monde ne peut pas créer sa page Wikipédia (ou celle de son entreprise). En l’occurence, un sujet est admissible s’il a fait l’objet de plusieurs articles de presse centrés sur lui, sur une période s’étalant sur au moins 24 mois (on parle bien de portraits complets, pas de simples mentions au détour d’un paragraphe).
C’est ce qui fait que la grande majorité des start-ups n’ont pas droit à leur page, aussi innovantes et talentueuses soient-elles. Celles qui sont présentes aujourd’hui sur Wikipédia n’ont plus à démontrer leur notoriété, comme Doctolib, Alan ou Qonto. Dura lex sed lex, mais un “non” n’est jamais définitif. Il faut plus le voir comme un “vous n’avez pas encore fait le buzz, mais je m’engage à vous accompagner lorsque ce sera le cas”.